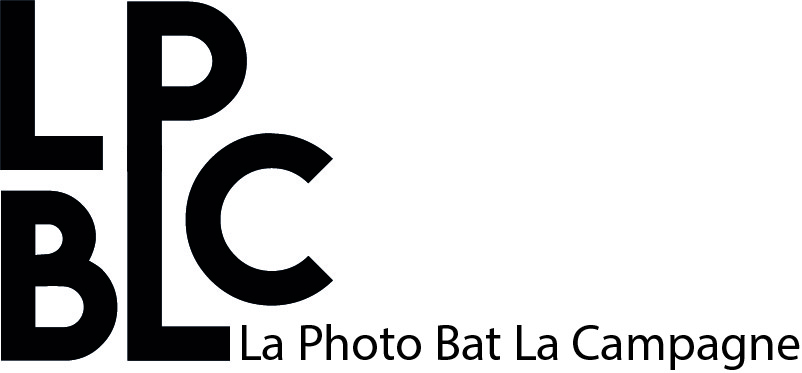Pays du Coquelicot — Association des aînés
Ateliers avec l'Association des Ainés d'Acheux-en-Amiénois
Journal de bord par Philippe Garon, écrivain et Valentine Vermeil, photographe
—
Philippe Garon le 20.03.2024
Quatrième atelier
Voici ma troisième tentative de tarte au libouli. Cette fois, je crois que c’est la bonne. Je l’enveloppe dans un linge à vaisselle et je prends la route pour ma dernière visite à la résidence pour personnes âgées. On se revoit avec plaisir. Fier d’être content, je leur montre ma tarte. Qui se mérite leur approbation. Avec un bon café, ça passe bien. On prend le temps de se retrouver. Mes textes ne sont qu’un prétexte. Chantal approuve celui que je lui ai consacré. Et les extraits que j’ai choisis pour le fanzine font leur bonheur. On parle d’un titre. Après quelques possibilités, on tombe d’accord pour « Des vies bien remplies ». Je suis content; c’est leur idée. Quand les gens s’approprient les projets que je leur propose, pour moi, c’est bon signe. Ce n’est pas vraiment notre dernière rencontre. On convient qu’à mon retour cet été, on prendra à nouveau du temps ensemble. Mais c’est quand même avec un pincement que je pars.
Philippe Garon le 21.02.2024
Troisième atelier
Je leur ai lu tout ça à voix haute. Quand il manquait des informations, quand on pouvait apporter des précisions, des corrections, on s’arrêtait et on ajustait. Puis, on vérifiait si ça marchait. Encore une fois, on a bien ri. Et à certains moments, on a eu le motton. J’avais apporté le goûter. Un gâteau aux bananes, auquel personne n’a touché, et une tarte au libouli. À l’unanimité, on a décrété que c’était un fiasco. La crème, ça allait, mais la pâte ressemblait à du mastic. Même s’il s’agit d’une recette rustique, y’a des limites. Mais je promets que la prochaine sera meilleure. Ou en tout cas, moins pire. En plus de mes quatre habitué.e.s, une nouvelle se joint à nous. Pour être en mesure d’écrire son histoire, nous convenons de prendre du temps ensemble, en privé. Je la suis jusque chez elle avec sa petite-fille Manon. Nous nous réfugions de la pluie fine en entrant dans la petite maison où elle vient d’emménager avec Jules, son mari, et leur fils Bertrand, parti faire des commissions. Alors voici :
C’est l’histoire de madame Caille. Chantal Caille. Elle a passé le plus clair de sa vie à Morchies, près de Bapaume, sur la ferme que son mari Jules a hérité de sa grand-mère en 1968. Grâce aux quinze hectares cultivés en location, le couple a pu élever ses quatre enfants, principalement par la vente d’endives et de poulets. Jusqu’à quinze mille poulets par année précise-t-elle, avec l’appellation « label », ce qui caractérise, si j’ai bien compris, les produits de qualité supérieure. Ça en fait ça, de la protéine d’excellence! Ce qui implique du travail. Beaucoup de travail. Ça peut paraître banal, mais quand je l’écoute, j’en viens à me demander si je sais vraiment ce que ça veut dire, moi, travailler. Née à Anzin-Saint-Aubin, Chantal a huit ans quand sa famille déménage à Vaulx-Vraucourt, en 1947. Son père travaille alors comme mineur à Aniche, un des hauts lieux de l’exploitation du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque matin, pour prendre l’autobus jusque là-bas, monsieur De Songnis doit se lever avant quatre heures. Deuxième d’une fratrie de cinq, Chantal explique que son nom de famille, qui contient une particule, révèle non seulement un rattachement à la noblesse, mais aussi à la descendance d’un des frères de Jeanne-d’Arc. D’ailleurs, elle entonne avec assurance, par cœur, une chanson rendant hommage à la Pucelle d’Orléans, dans laquelle les mots « stoïque » et « héroïque » riment avec « patriotique ». Un chant qui parle de son étendard, mais que je n’arrive pas à retracer sur Internet. Soit que je cherche mal, soit qu’elle ne s’y trouve pas. Le numérique a ses limites. Et je me rends aussi compte à ce moment-là de mon manque de connaissances face à ce personnage clé de l’histoire de France, lacune que je tente aussitôt de corriger par quelques vidéos de vulgarisation. J’apprend qu’elle s’entendait bien avec Michel, l’archange pourfendeur de dragons. D’ailleurs, il paraît qu’il serait déjà venu par ici, dans la forêt de Compiègne pour être plus précis, question de débarrasser population d’un saurien démoniaque. Faudra que j’en parle à mon maître Michel Faubert, lui qui adore tout ce qui se rapporte aux mystiques gothiques.
Mais revenons à l’histoire de Chantal. Après les avoir nourris pendant près de trois ans, les habitants de Morchies se voit évacués par les Allemands en mars 1917. Obligé de se retirer vers la ligne Hindenburg devant les succès des Alliés, l’ennemi détruit entièrement le village, allant même jusqu’à couper les arbres et polluer l’eau des puits. La ferme de la famille Caille n’y échappe pas. Les grands-parents de monsieur Jules se réfugient pendant deux ans à une cinquantaine de kilomètres de là. Et comme un malheur arrive rarement seul, c’est pendant ces temps d’instabilité que l’aïeul du clan meurt. Après le conflit, il faut tout reconstruire. Et nous voilà, plus de cent ans après. C’est au tour de Chantal, de Jules et de Bertrand, gravement handicapé, de devoir quitter la maison. On peut difficilement concevoir ce que ça représente, être obligé de partir de chez soi à cause de la maladie, du poids des années. Il a fallu se débarrasser des oies, ce redoutable animal de garde, bon concurrent du chien, qui signale bruyamment l’arrivée de tout intrus, allant même jusqu’à lui pincer le derrière au besoin. Braves bêtes. Bertrand a dû se séparer de son âne, de son poney. Quelqu’un prend soin d’eux, le propriétaire d’un restaurant, proche de Doulens. La clientèle va bénéficier des deux nouveaux pensionnaires sympathiques de la fermette. Mais Bertrand lui, doit maintenant apprendre à vivre sans ses deux vieux amis.
Même en me donnant des détails sur la vie rude qu’elle a dû mener, Chantal ne perd pas son sourire. Ils n’ont pas roulé sur l’or. « Mais on doit rien à personne. » dit-elle, sans vanité. Quand je lui demande ce qu’elle a le plus aimé, ma question semble l’étonner. Elle me répond avec simplicité « Travailler. », comme s’il s’agissait là d’une pure évidence. Manon, sa petite-fille cachée dans un coin de l’appartement, ajoute de sa voix enjouée : « T’aimes bien Jésus! » Bien que réfugiée derrière sa tablette électronique, elle n’a peut-être rien perdu de toute notre conversation. Chantal sort son rosaireen billes de bois noires. Je serais pas capable de dire un chapelet, mais je connais vaguement le principe. J’essaie de comprendre avec elle comment ça marche, les prières qui totalisent maintenant vingt « mystères » depuis les ajouts apportés dans le temps de Jean-Paul II. Joyeux, douloureux, glorieux, lumineux. Personnellement, j’y vois tout bonnement une forme de recueillement. Sa conscience face au mystère de l’existence. Je trouve que ça mérite le respect. « Quand on était dans l’agriculture, j’avais pas le temps. » Ça me fait penser à la piété de mes grands-parents. À un gars de Gaspé que je connais, Jérôme, dont le père vient du même village que le mien. Il tient à sa foi catholique. Pas fanatique pour deux cennes. Juste intéressé à mener la meilleure vie possible en se basant sur cet héritage spirituel. Mais il sent bien le jugement que sa religion pourrait susciter s’il osait en parler. Que les gens trouvent ça bizarre, dépassé voire franchement malsain considérant tout le mal perpétré par l’Église. Ça laisse quand même perplexe comme rigidité sociale vue l’obsession actuelle du respect des différences. Tant mieux pour celles et ceux qui font du yoga ou de la méditation, si ça leur fait du bien. Mais qu’est-ce qu’il y a de mal dans la manière de vivre des Chantal et des Jérôme de ce monde? De trouver du réconfort dans la prière et dans la messe? Dans les liens familiaux, amicaux, humains? Dans d’humbles silences devant l’immense? Chantal est presque aveugle à cause de son diabète. Comme tous ses frères et sœurs. C’est héréditaire. Et elle n’entend plus très bien. Mais elle est une bonne personne. Honnête. Pendant l’heure et demi que j’ai passée avec elle, le téléphone a dû sonner au moins cinq fois. Une de ses filles, une cousine, un ami. Un entourage loyal. Un royaume tout petit. Mais où elle est souveraine.
Philippe Garon le 7.02.2024
Deuxième atelier
Cette nuit, je me suis payé un rêve sublime. Ça se passait dans une baie de Gaspé magnifiée. Des dizaines de baleines à bosse batifolaient à qui mieux mieux. L’eau revolait en vagues de perles sous le poids de leurs jeux gracieux. Sur quelques roches claires à pente douce détachées des falaises de Forillon, des touristes mollement vêtu.e.s, étendu.e.s sur leur serviette de plage, belles et beaux comme Nelligan, se faisaient rissoler la couenne au soleil excessif. Je retrouve avec bonheur mes grands-parents adoptifs. Notre complicité de la première rencontre revient instantanément. La question « Comment ça va? » suffit pour nous relancer dans une conversation à bâtons rompus. Le tison de mon crayon se ravive aussitôt. Je prends des notes en vrac, amasse une brassée de souvenirs, que je rattache à ceux que nous avons déjà partagés. En essayant d’y mettre de l’ordre, voici ce que je trouve.
***
C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Yvonne. Elle vit sur une ferme à Château des bois, près de Quesnoy-sur-Deûl, avec ses parents et ses dix frères et sœurs. Yvonne aime vivre sur une ferme. Les vaches, le cheval, les cochons, les lapins, les moutons, le coq, les poules, le brouhaha de tous ces animaux-là, ça fait son bonheur. Chez elle, ça sent l’air, la nature. Ça ne la gêne pas, les odeurs de fumier. Bon, c’est vrai que le cochon, ça sent moins bon. Mais on s’habitue. Surtout que, c’est bien connu, tout est bon dans le cochon. À chaque année, le premier dimanche du mois d’août, on célèbre saint Albert. Dans la famille d’Yvonne, cette journée-là est une journée de détente et de dévotion. Yvonne a reçu une médaille de saint Albert en cadeau de la part de ses parents. Puis en passant, Albert, il aurait la capacité de purifier miraculeusement l’eau des puits.
Ceci dit, parmi les différents produits issus du labeur de la famille d’Yvonne, on retrouve du beurre. Sauf qu’un beau jour, voilà t’y pas que la baratte refuse d’obtempérer. Le père d’Yvonne se gratte la tête, la regarde de tous bords, tous côtés pour voir qu’est-ce qui peut bien clocher. Avec sa femme, il se dit que c’est peut-être avec leur crème qu’il y a un problème. Il parle avec ses vaches, leur demande si quelque chose ne va pas. Les vaches répondent que tout va bien. Il les change quand même de pacage, tout d’un coup que ça aiderait. Rien n’y fait. Est-ce que le père d’Yvonne a essayé sa baratte avec la crème d’un voisin? L’histoire ne le dit pas. Toujours qu’un jour, découragé, il s’adresse aux pères d’Ypres. Les bons religieux viennent à la maison prier saint Albert en s’agenouillant devant la baratte. Les moines prient, puis prient, puis prient. Puis après la prière, ils s’en retournent à Ypres. Le lendemain, la baratte donnait du beurre à nouveau.
Une autre fois, les vaches sont tombées malades. Les dominicains d’Ypres étaient justement de passage pour la première communion d’un des frères d’Yvonne. Mais cette fois-là, ils ont pas trouvé la cause du problème. Ils ont juste dit à son père : « Ça vient peut-être de la mare, Robert. Mais on peut rien faire... » Le temps a passé. Yvonne a eu sa propre ferme avec son mari, à Marquion. Ils ont cultivé beaucoup de patates dans leur vie. Yvonne se revoit d’ailleurs aller livrer des voyages de patates en tracteur chez Mc Cain. La compagnie canadienne spécialisée dans les frites surgelées a des usines ici. Oui, c’est vrai, c’est une grosse multinationale, un fleuron du capitalisme qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5,7 milliards de dollars. Mais elle n’est pas cotée en bourse. Mc Cain, c’est une affaire de famille. Qui emploie autour de 20 000 personnes. D’ailleurs, un des neveux d’Yvonne continue le trafic de pommes de terre avec Mc Cain et compte lui-même plus de trente employés. Yvonne, elle, ne va plus livrer de patates à l’usine en tracteur. Elle a assez travaillé. Elle se repose maintenant, en souriant. Mais elle porte toujours la médaille de saint Albert que ses parents lui ont donnée quand elle était petite.
***
C’est une histoire qui commence à Warloy-Baillon, le village natal du grand folkloriste Henri Carnoy. Un jeune homme vit en face de la place du Fort, où l’on retrouve justement le buste en bronze de Carnoy. Le jeune homme en question s’appelle Claude. Claude aime travailler le bois. Mais son père veut pas qu’il devienne menuisier, sous prétexte que c’est pas avec ce métier-là qu’il va pouvoir bien gagner sa vie. Claude décide alors de devenir apprenti mécanicien. C’est un garçon brillant. Il apprend vite, ça va bien. Tellement bien qu’il décide de partir sa propre affaire. Et toute sa vie, il travaille comme garagiste. Dans le village, tout le monde le connaît. Quand on a un problème de mécanique, on sait qu’on peut compter sur lui. Même quand on manque d’argent. Claude a beaucoup de clients qui cultivent des endives. Des fois, il accepte de se faire payer en chicons. C’est bon les chicons. Braisés, en velouté, en salade ou gratinés avec du jambon. Puis Claude, il aime ça rendre service. En plus, il aime les voitures. Sa préférée, c’est la DS. Claude a eu trois DS dans sa vie. Même s’il était pas attaché à l’argent, il en a jamais manqué. Un jour, il a même pu s’acheter un petit bateau à St-Vallery-sur-Somme. Un canot breton avec une petite cabine. Claude a passé du beau temps à naviguer l’été le long de la Côte d’Opale. Il se souvient du port, là-bas, avec les maisons de pêcheurs en torchis, peinturées de toutes les couleurs, avec leurs petits jardins fleuris. Il se souvient de Hardelot-Plage. Il se souvient des sauterelles; c’est comme ça que les gens de là-bas appellent les crevettes. Il avait baptisé son bateau « L’Yonne ». Claude en prenait soin. Un bateau, ç’a besoin d’amour. Parce que pendant tout ce temps-là, Claude, il a toujours continué à aimer travailler le bois. Même s’il en a pas fait son métier, il s’est acheté plein d’outils. Il a fabriqué plein de meubles au fil du temps. Puis pour ses quatre-vingts ans, il a préparé quatre-vingts porte-serviettes en forme de bateau. Une grande fête a été organisée avec la famille puis les amis. Pour l’occasion, on a commandé une immense paella chez un traiteur. Est-ce qu’il y avait des sauterelles dedans? On le sait pas. Mais on sait que tout le monde est reparti à la maison avec un porte-serviette en forme de bateau bricolé par Claude.
***
C’est l’histoire de Théodorine, née en 1931 à Ablain-Saint-Nazaire. Le pays des Boyaux-Rouges. Pas facile de savoir exactement l’origine de ce surnom-là. Une hypothèse veut que les habitants de l’Artois, malgré leur rattachement au royaume de France en 1659, aient conservé certains privilèges, dont celui de ne pas payer la gabelle, soit l’impôt sur le sel. Par jalousie, les Picards se seraient mis à dire que les gens du Nord avaient les « boyaux rouges à force de manger du sel ». Pour d’autres, ça viendrait plutôt de l’alliance, au XVIe siècle, avec les soldats espagnols, qui portaient des ceintures rouges. Ou bien de la grande consommation de betteraves et de choux rouges par les Artésiens. Ou encore, du sang qui coulait dans les ruisseaux de la région lors de la Révolution et des deux grandes guerres. On évoque également l’allégeance politique plus à gauche, voire communiste, des gens du pays. Bref, pas évident de savoir exactement d’où leur vient ce sobriquet[1]. Ceci dit, une autre de leurs caractéristiques, c’est de pouvoir monter sans pédaler. Alors, pas étonnant qu’ils fassent des envieux.
Par ailleurs, pour ceux qui le savent pas, c’est dans le village de Théodorine qu’on retrouve la plus grande nécropole militaire de France, Notre-Dame-de-Lorette. Quarante-cinq mille morts. Mais bon, des chiffres comme ça, c’est dur à concevoir. En 2014, on a inauguré sur le même site un anneau de la mémoire sur lequel sont inscrits six cent mille noms de soldats tués entre 1914 et 1918 dans le Nord et le Pas-de-Calais. 600 000. Moi, ça me donne le vertige tellement c’est dur à imaginer. Mais malgré ça, on continue.
Théodorine s’est mariée en 1949. Moi, je l’appelle « Madame Dufour », parce que c’est un nom de famille assez courant au Québec. Mais c’est le patronyme de son mari. Je ne connais pas son nom de « jeune fille », comme on dit. Mais je devrais l’appeler « Théodorine » ou plutôt « Madame Théodorine », tiens, pour faire moins familier tout en utilisant son prénom, joli et inusité. Bref, madame Théodorine a connu son homme ici, à Albert. Elle était venue travailler chez un cousin Mignotte; cette famille-là, c’était des marchands de bestiaux. Mais un des frères avait sa propre affaire; il tenait une buvette. La femme du marchant de bétail, c’était la cousine d’une certain Pierre. Alors voilà. Théodorine et Pierre ont eu quatre enfants. De son côté à lui, il y avait une veuve de guerre qui possédait un café débit de tabac à Forceville. C’était sur la rue d’En Bas, près du monument aux Morts. Il y avait une salle de bal. Ça s’appelait « Le Café du Siècle ». Théodorine et son époux ont repris le commerce. Ça allait. Jusqu’à la mort d’un de ses fils. Il avait huit mois. Alors, quand elle a perdu son bébé, elle a arrêté le café. Et sa sœur a racheté l’affaire. J’aime parler avec madame Théodorine. Même au repos, son visage s’éclaire d’un large sourire où brille une dent en or. Comme un petit bout de soleil dans sa bouche. Dans la grisaille de la Somme, elle donne de la lumière, sans se forcer.
***
C’est l’histoire de Jeannette. Madame Delory. Marzalek de par ses grands-parents. C’est polonais. Elle a d’ailleurs été élevée par sa grand-mère polonaise. Jeannette a vécu du côté de Varsovie de deux à treize ans. Là-bas, on l’appelait Jeannine. Cette famille-là était arrivée à Bray-sur-Sommes en 1933 pour travailler chez des cultivateurs, proche de Suzanne.
L’histoire de Jeannette se passe à La Motte-en-Santerre. Depuis la fusion de 1974, ça s’appelle Lamotte-Warfusée. Une place où la grande chaîne des générations se donne la main depuis l’Antiquité. L’église là-bas est une manière de chef-d’œuvre d’Art déco. Le village ayant été minutieusement pulvérisé pendant la Première Guerre, on devait repartir à zéro. Le hic, c’est qu’avec sa flèche en dentelle de béton et son armature, en béton itou, cette église-là casse de partout. Les infiltrations d’eau ont effacé le plus gros des décorations intérieures, réalisées par un artiste italien. Dommage. Dire que tout ça date d’à peine cent ans. Quel matériau nul que le ciment… Lorsque je rencontre Jeannette, elle porte l’alliance de son défunt Jacques sur la chaîne qui lui vient de sa mère, Angèle. Au moment du décès de son père, à quarante-et-un ans, dans un accident de moto, ça faisait à peine deux mois que sa mère avait accouché de sa petite sœur. Jeannette avait dix-sept ou dix-huit ans. En tant qu’aînée des six enfants, elle s’en est occupée de son mieux. Sa rencontre avec Jacques remonte à un bal de village, un samedi soir. Ils se sont mariés le 28 avril 1956. Jean-Jacques est né deux ans après, jour pour jour. Il est lui-même le père de trois enfants et sa sœur Annick a aussi donné une petite-fille à Jeannette.
Dans sa jeunesse, Jeannette a travaillé chez des bourgeois de Calais qui avaient acheté une ferme à Suzanne. La famille Noyon. Avec cent hectares, c’était de gros propriétaires pour le temps. Elle en garde de bons souvenirs. Là-bas, elle s’occupait des trois enfants du couple puis de la grande maison, en plus d’aider dans les champs, même si la patronne n’aimait pas trop. Jeannette a appris beaucoup chez eux. Après, avec son mari, ç’a été la vie de cultivateur; la terre, les pommes de terre, les betteraves. Jacques, qui avait aussi un emploi de transporteur, est arrivé un jour à la maison avec un mouton. Un bébé qu’elle a dû nourrir au biberon. Peut-être qu’il ne fallait pas lui donner de nom. Jeannine se rappelle de ce mouton, ou plutôt de cette brebis, puisqu’elle l’appelait Nanette. « On l’a vendue, qu’elle me dit. J’ai pleuré quand elle est partie. Et elle aussi, elle avait les larmes aux yeux.» Avec Jeannette, on parle de la tarte au libouli. Certains l’appellent « tarte à gros bord », parce qu’avant d’avoir des moules, les cuisinières la préparaient en façonnant la pâte avec des bords épais, pour bien contenir la crème. De la crème au lait bouilli d’ailleurs, ce qui, en patois, donne justement le mot « libouli ». Si je comprends bien, on peut aussi parler de tarte à l’badré, recette typique de la Picardie qui remonterait au XVIe siècle. Et qui, selon Wikipédia, serait quasiment tombée dans l’oubli. En tant qu’obsédé de patrimoine, moi, ça me donne le goût d’essayer d’en préparer. En passant, après une petite recherche, je trouve que le mot « badré », c’est tout simplement une autre manière de dire « bouilli » dans la parlure d’ici.
***
C’est l’histoire d’Annie. Annie, c’est un sacré numéro. Drôle, charmeuse, pétulante, lumineuse. On est faits pour s’entendre elle et moi. Première d’une famille de quatorze, sa joie de vivre a fait bien des pieds de nez au destin depuis 1939. Quatorze, ça semble d’ailleurs être un nombre d’or dans son clan, puisque sa grand-mère Lucia a aussi eu ce nombre d’enfants. Tout ça se passe à Mareuil-Caubert si j’ai bien compris, au sud d’Abbeville, dans un temps disparu. La Annie d’aujourd’hui partage sa vie avec la déesse Isis. Ou du moins, son incarnation canine. Ensemble, elles écoutent la radio, du matin au soir. Annie aime plusieurs genres de musiques, de André Rieux à Pavarotti en passant par Chopin, Strauss, la grande musique quoi, et les champions du musette, comme Michel Pruvost, Pascal Sevran et André Verchuren. Elle dit : « Ça me vient de mon grand-père, Gaston Gaillard. Il était musicien. Il avait un orchestre. Il jouait de la mandoline puis il composait aussi. Il est mort, j’avais huit ans. Il a quand même été l’homme de ma vie. Il m’a élevée, il m’a aimée beaucoup. J’avais neuf mois quand mon père a été fait prisonnier par les Allemands alors c’est mes grands-parents qui se sont occupés de moi. Ma mère s’appelait Paulette, comme dans la chanson. » Bon, ici, je dois avouer mon ignorance. Mais une petite recherche me mène tout droit à un classique des Charlots; ça doit être ça. Elle pense aux instruments de musique du grand-père. Difficile de les nommer. Elle croit qu’il y avait un trombone à coulisse, entre autres. Un clairon aussi. Et bien plus. Un diapason, ça serait d’adon. Un métronome, oui, ça, c’est certain. Tout cet attirail se trouvait dans le grenier. Avec plein de partitions. Malheureusement, elle ignore où c’est rendu. Mais elle associe encore la musique à l’odeur du café et du ragoût de pieds de cochon. Même aujourd’hui, l’écho des mélodies continue de résonner dans sa tête. Le tic-tac du métronome aussi. Et une mélodie en « Badabaloum! » rigolos qui étrangement, l’endormait; allez savoir pourquoi.
Annie, une autre activité qu’elle aime, c’est danser. Ça arrive quand on est mélomane. La valse, le tango, la java. Mais son Jean-François, lui, il aimait pas ça. Qu’à cela ne tienne. Avec sa tante, elle s’en donnait à cœur joie. Et maintenant, c’est avec Isis la chienne égyptienne qu’elle continue à se dégourdir les mollets. Il faut dire qu’Annie a du métier. La belle époque des bals, des rendez-vous dans les salles des fêtes, elle a connu ça. Ces soirées-là coûtaient une bagatelle. Et le 14 juillet, on se retrouvait à la guinguette en plein air, gratuit. C’était un temps où le bonheur chahutait sans fla-fla. Ça donnait lieu, disons, à différents échanges entre les villages. Souvent, les gens devaient traverser les bois pour aller à ces événements-là. Et il arrivait que certains en profitent pour regarder les feuilles à l’envers. Même la Deuxième Guerre n’a pas détruit l’art de se faire plaisir. Annie, à cette époque, elle était toute petite, elle n’avait que sept ou huit ans. Elle allait de bonne heure aux fêtes de village. « Tu me raconteras tout. », lui disait le grand-père Gaston. Oui, la petite fille allait là pour guincher sur les airs d’accordéon. Mais avec tous ses sens en éveil, elle mettait sa curiosité au service de son aïeul préféré. Annie, il n’y avait rien à son épreuve. Il fallait la voir dans les bois. On la surnommait « la fille de la jungle ». Une vraie Jane à Tarzan. Avec les autres enfants, on s’amusait ferme dans la forêt du vieil oppidum, sur les hauteurs au nord de la commune. Elle n’avait pas son pareil pour s’élancer au bout d’une liane et attraper les singes.
Pour aller en classe, Annie devait traverser les étangs de Mareuil-Cobert à l’aide d’une barque. Une barque fabriquée par son père. En tant qu’aînée, elle avait la responsabilité de s’occuper de deux de ses sœurs lors de ces équipées pour se rendre à l’école. Un jour, Rosine s’est comportée en imbécile. Elle a passé par-dessus bord. Sans l’intervention d’Annie, elle se noyait. Elle se souvient l’avoir tirée par les pieds. Une fois à bord, sa petite sœur était bleue. Ça fait soixante-dix ans de ça. Et souvent, la nuit, Annie se réveille en criant « Rosine! Rosine! » Et à chaque fois que Rosine vient la visiter, elle lui répète toujours la même ritournelle : « Toi, tu m’as sauvé la vie. » Annie pense souvent à ça. À ses deux enfants aussi, Fabrice et Élizabeth. Et à son grand-père Gaston. Tous les jours en fait. Elle pense à lui.
[1] https://www.lavoixdunord.fr/1083824/article/2021-10-13/pourquoi-surnomme-t-les-habitants-du-pas-de-calais-les-boyaux-rouges
Valentine Vermeil le 31.01.2024
Premier atelier
J’ai rdv à 14h avec Annie, Yvonne, Claude, Théodorine et Jeanette. La neige avait annulée notre première rencontre, mais j’avais participé à l’atelier de Philippe pour faire leur connaissance. Théodorine a une visite de famille donc elle n’est pas avec nous aujourd’hui. Marion a installé le vidéo-projecteur dans la salle, et pour leur faire part de ce qui me plait le plus en matière d’image, je leur propose de regarder quelques peintures. J’ai sélectionné des portraits en clair-obscur de Vermeer, Van Eyck et Rembrandt, une nature morte très minutieuses de Bruegel, une autre plus enlevée de Valoton et une dernière presque abstraites de Cézanne. Philippe les avait questionnés sur un objet importants pour eux, je poursuis cette idée et j’oriente la séance sur la PDV de photos d’objets chez eux.

Philippe Garon le 24.01.2024
Premier atelier
Rectification. C’est pas un fantôme qui tapoche sur des chaudrons dans le grenier; c’est le diable en patins à roulettes. Aujourd’hui, c’est la fête à Saint François de Salle, patron des journalistes. Mais aussi mon patron à moi. Bonne fête patron! Le 24 janvier, c’est aussi le jour du taureau dans le calendrier républicain. Mon signe astrologique. Tout ça est de bon augure.
En chemin vers la résidence pour personnes âgées, je demande à Émilie si elle sait pourquoi il y a un paquet de petites maisons abandonnées sur les rives de la Somme dans le bout d’Étinehem-Méricourt. Elle démolit en deux coups de cuillère à pot mon hypothèse d’une épouvantable catastrophe causée par un monstre mutant radioactif. L’explication s’avère légèrement plus prosaïque. Depuis longtemps, des estivants venaient pêcher l’été par ici en camping sauvage. « Sauvage » dans le sens de « illégal ». Mais bon, c’était toléré, considérant que ces gens d’en dehors contribuaient quand même au commerce local. Sauf qu’avec le temps, dans plusieurs cas, les petites installations sommaires se sont transformées en maisonnettes pas mal élaborées. Avec l’altération de l’environnement que ça implique. Disons que plusieurs de ces visiteurs ont poussé le bouchon un peu trop loin. Sanitairement parlant notamment. L’administration a fini par se tanner. Dorénavant, c’est dans des campings contrôlés, avec loyer payé à l’année, que les touristes devront s’installer pour taquiner le sandre, la carpe, le brochet, le silure ou l’anguille. Fini le squat. Surtout que, si je comprends bien, une mobilisation visant à créer une aire protégée en faveur des multiples espèces d’oiseaux qui nichent dans le secteur remporte pas mal d’adhésion. Mais ça ne se fait pas sans frictions. Bref, voilà peut-être une idée à creuser pour le volet « création personnelle en duo » de notre projet, à Valentine et à moi. Et Émilie de renchérir, en me prouvant que ma théorie du monstre n’est pas si farfelue que ça. Dans la tradition locale, une croyance veut que Marie Groette hante les cours d’eaux, marais et étangs de la région. Armée d’une fourche, cette sorcière à l’haleine fétide, tellement laide qu’elle arrête le sang, s’attaque aux enfants qui osent s’aventurer sur son territoire pour les amener dans sa grotte… Ah! Ah! Je le savais bien que j’avais raison!


Mais nous voilà à la résidence d’Acheux. Le coordonnateur du service de zoothérapie me souhaite la bienvenue avec zèle. Olane qu’il s’appelle. Très affectueux. Ses affables collègues à deux pattes me reçoivent avec presque autant d’empressement. Marion et Delphine me guident vers le petit local où je vais rencontrer mes aimables collaborateurs. Et je fais bientôt la connaissance d’Annie, Claude, Théodorine, Jeanette et Yvonne, pour me rendre compte que le qualificatif d’« aimable » n’est qu’un piètre euphémisme pour les décrire. En moins de temps qu’il n’en faut pour dire « Bonjour ma tchot pére! », on s’entend comme cul et chemise. Je les adore! Je capote bien raide! On me parle des bêtises de Cambrai, ces confiseries nées d’une erreur. On me parle de Saint Albert, miraculeux réparateur de barattes à beurre. On me parle d’amour de la danse, de Michel Pruvot, Pascal Sevran et André Verchurenne, vedettes des bals musette, et de cette activité facultative que favorise les fêtes de village, à savoir de s’adonner au regardage des feuilles à l’envers. On me parle de papa, fait prisonnier par les Allemands et revenu à la maison après quatre ans de détention. On me parle de betteraves, de patates, de chicons. On me parle de lapins, de basses-cours, de vache et d’un petit mouton nourri au biberon. On me parle de familles de quatorze enfants et de Citroën DS. On me parle de parents immigrés de Pologne en 1933. On me parle de la vie d’avant dans la région. Un vrai régal. Mon crayon passe proche de prendre en feu. Je prends quinze pages de notes pendant l’activité. Gratitude. C’est la joie, bord en bord. On se dit à la prochaine, tout sourire. Olane, l’épagneul mélangé border colley, me raccompagne à l’entrée. Je porte pas à terre. EDF devrait se brancher sur moi; ça règlerait la pénurie d’énergie.