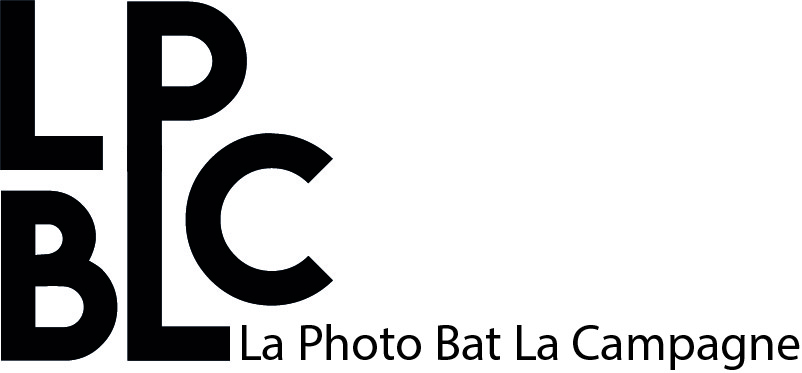Je me sens bien avec toi - partie 2
Je me sens bien avec toi - partie 2
Journal de bord par Philippe Garon, écrivain
Dimanche 28.01.2024
Je prends le train pour Paris à dix heures trois (bon, ça pourrait être plus précis, mais on va faire avec). Une heure de battement entre deux trajets me permet de mieux visiter Amiens. Je vais du côté des canaux. Magnifique. La ville mérite pleinement son surnom de « petite Venise du nord ». Il fait soleil, c’est moins froid donc je peux mieux apprécier avant de m’en retourner me laisser porter plus au sud par la SNCF. Sitôt sorti de la gare du Nord, une cycliste tente de m’assassiner : « Surtout, prends ton temps! » qu’elle me lance avec la mauvaise humeur proverbiale des citoyens de la place. Je me sens mal pour une couple de kilomètres, le temps qu’un escadron de quêteux me sollicite. Ça me change les idées. Mon sens de l’orientation en arrache. J’atteins quand même la porte St-Martin; je ne me suis pas trop éloigné de la ligne pas trop croche qui devrait me mener à mon objectif, à moins de deux heures de marche plus loin, soit le théâtre Silvia Montfort, dans le parc Georges-Brassens. Alors je passe le centre Georges-Pompidou, le pont Notre-Dame et la cathédrale du même nom, en reconstruction. Je passe le Panthéon. J’arrive au jardin du Luxembourg, ce qui me permet de marcher à l’écart de la circulation et d’entendre une violoniste interpréter le Cygne de Saint-Saëns, ce qui mérite bien les deux maigres euros que je dépose dans son étui, considérant le froid avec lequel elle doit se chamailler. Je continue par l’esplanade Gaston Monerville, me rend jusqu’à l’observatoire de Paris et aboutit devant le beau gros minou de la place Denfer-Rochereau. Mais le temps passe. Le spectacle que je m’en vais voir avec l’ami Laurent commence à seize heures. Et là, sans m’en rendre compte, je me retrouve assez décalé par rapport à la trajectoire que j’aurais normalement dû emprunter. Je dois hâter le pas. L’architecture du Quatorzième arrondissement me paraît pas mal moins élégante. Dans un square, je vois qu’un spectacle de guignol se prépare. Mais je déchante en voyant l’affiche : Guignol et la reine des Neiges… Même ça, on trouve le tour de le gâcher. Que c’est pénible… Et malgré les plans de la ville que je consulte ici et là, près des bouches du métro, je n’arrive toujours pas. Un affable monsieur m’aide à me repérer, mais on dirait que je vais arriver en retard. J’avance bon pas, malgré les employés municipaux qui nettoie avec de grands jets d’eau les déchets laissés par la tenue d’un marché. Enfin j’arrive et miracle, à temps. Je peux même prendre un instant avec Laurent pour une petite jase avant que la pièce commence. « Hidden paradise », la pièce avec Alix et Freddo, les compatriotes qui ont traversé la mare en même temps que moi. Un vortex qui tourne autour des mots d’Alain Denault, qui nous met la face drette dans l’absurdité des paradis fiscaux. La performance ultra exigeante du tandem nous amène à rire, oui, mais aussi à ressentir l’angoisse de cette violence institutionnalisée, tolérée, banalisée, érigée en système, en toute impunité.
Les deux interprètes arrivent dans le bar jouxté à la salle de spectacle. Épuisés, mais quand même galvanisés. Avec Laurent, on boit une bière en compagnie de Freddo. On se connaissait de nom, mais c’est la première fois qu’on se rencontre. Pas la dernière j’espère.
J’emboite le pas à Laurent pour le trajet jusque chez lui. Il me guide avec aplomb dans le métro. Je m’étonne de la masse compacte de chair humaine qui remplit l’espace, même si c’est le jour du Seigneur. On parle de l’érosion du civisme mon ami et moi. Dans le train, c’est le même refrain. Paris, ville lumière? Quelle bonne blague! Son élégance architecturale, éclairée même la nuit par ses lampadaires depuis le XVIIe siècle, n’est-elle pas assombrie par une grande éclipse de dignité?
À la maison, je retrouve le reste de la famille. C’est fou comment ç’a changé depuis ma visite de l’an passé. Delphine est une virtuose du marteau. Difficile à battre en fait de rénos. En plus, le fumet d’une belle soupe costaude remplit la nouvelle cuisine et la salle de séjour, véritable réussite. Mais Laurent me tend une boîte avec un air narquois. J’ouvre la boîte. Un cadeau exagéré. Laurent m’offre une pure merveille de couteau : un Morta. Moi qui, dans une vie antérieure, me suis fait confisquer de manière nébuleuse un Laguiole par Air Canada, me voilà gâté. Comment le remercier? Voilà une amitié de trente ans qui continue de se bonifier. En attendant de trouver la bonne idée pour lui rendre la monnaie de sa pièce, je respecte la superstition en lui donnant un sou noir. La soirée se termine en regardant une drôle d’émission; Nus et culottés. Avec un épisode sur le Québec en plus. Normalement, je devrais me laisser charmer par cette fable à mi-chemin entre la télé-réalité de sobriété heureuse et le documentaire écologiste. Moi qui suis normalement d’une crédulité crasse, sans vouloir décevoir mes hôtes, je n’arrive malheureusement pas à embarquer totalement dans la proposition; impossible que ce soit purement le fruit du hasard. Comme on dit chez nous, c’est arrangé avec le gars des vues. Il y a le travail de fou de toute une équipe de recherchistes et de techniciens derrière cette pseudospontanéité, j’en suis persuadé. Alors difficile pour moi de rire à gorge déployée ou de me laisser émouvoir. Oui, j’avoue que ça donne quand même de la bonne télé. Mais est-ce que c’est vraiment honnête? Ceci dit, il est presque minuit. Le cadet de la famille, généreux comme ses parents, me laisse encore sa chambre. Dodo.
Lundi 29.01.2024
Avant de partir, j’aide Laurent à placer une partie de sa bibliothèque dans le nouvel espace de rangement que crée l’installation d’une robuste poutre en acier. Ces livres en format poche patientaient dans des cartons depuis le dernier déménagement vers leur nouvelle maison. Ils ont failli se retrouver chez un bouquineur. Mais les voilà sauvés et mis en valeur dans un bel écrin insolite, au son du groupe Delgres. Kessel, Cendrars (dont j’ai commencé « La main coupée », séjour dans la Somme oblige), « Tu seras un homme mon fils » de Kippling, « Le Grand Meaulnes » d’Alain Fournier, « L’espoir » de Malraux, « Kaputt » de Malaparte, « Le salaire de la peur » de Georges Arnaud, « Les faux-monnayeurs » de Gide, etc., etc. Un beau paquet de pages à conquérir. Ça le représente bien. Épris d’aventure, mais loyal comme le granit. Sérieux, mais joyeux. Solide, mais sensible.
On se rend ensemble à son bureau. Il me présente quelques-uns de ses collègues policiers de la SNCF. Un des jeunes agents m’expliquer l’équipement qu’il porte; la veste pare-balles, le pistolet, la bombe lacrymogène, la caméra numérique. Tout ça quand même avec bonne humeur. Mais ça prend du cran pour ce genre de métier. Laurent et moi, on se donne une franche accolade et je repars de mon côté. Au rythme des traverses de la voie ferrée, je retourne dans « La main coupée ». Même si on ne se comprend pas à 100% dans nos parlures respectives Cendrars et moi, on vit une belle amitié. Et sa combativité m’impressionne. Comme homme de lettres et comme homme tout court. Il va d’ailleurs m’accompagner toute la semaine. Mes jours suivants vont s’écouler dans l’écriture et la lecture, sous une bonne grisaille picarde. Comme mon horaire ne comporte aucun atelier, je consacre le maximum de mes journées aux mots. Les miens et ceux de l’écrivain mutilé par la guerre de 14-18. Quelle expérience troublante que de lire ce récit en habitant tout près des lieux qu’il décrit, théâtre de cet invraisemblable massacre. Mais sa vigueur littéraire me tape dans le dos. Je ne suis peut-être pas un génie de la langue, mais je crois en sa magie.
Samedi 10.02.2024
Je ne sais pas si je crois en Dieu. En même temps, je me trouverais vaniteux de déclarer catégoriquement qu’il n’existe pas. Qui suis-je pour exprimer de manière péremptoire une telle opinion? Et je parle bien d’opinion, parce que pour ce domaine d’intérêt, à ce que je sache, on ne se situe pas trop dans le territoire des certitudes.
Je me suis intéressé à Nietzsche il y a quelques années. De mes deux tentatives de lecture d’Ainsi parlait Zarathoustra, je ne saurais dire ce que je retiens. Peut-être que le comprendre se trouve au-dessus de mes « moyens intellectuels », pour paraphraser Dany Laferrière. Mais la bonne vieille maxime de monsieur Boileau me revient dans ce genre de situations : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. » Or, quand je me rends compte que les exégètes du célèbre philosophe allemand se perdent en conjectures pour interpréter à peu près tous ses concepts, je me sens moins mal de ne pas trouver sa prose limpide. Je conviens que la formule « Dieu est mort », ç’a de la gueule. Et d’un point de vue esthétique, je dois aussi reconnaître que le style de Nietzsche s’illustre brillamment. Ceci étant dit, pour moi, enrober ses idées dans une gibelotte dialectique indigeste, me semble que ça ne suffit pas pour crier au génie. Je pècherais par excès de désinvolture en qualifiant son œuvre d’esbroufe. Mais personnellement, pour m’accompagner dans mes interrogations métaphysiques, elle ne m’aide pas beaucoup. Surtout quand on se remet en tête que le même idéologue propose la notion de « surhomme », qui serait de nature égale au divin, il y a de quoi se demander si au fond, il ne cherchait pas surtout à nous faire tourner en bourriques. Bon. C’est très sérieux tout ça. Devant quelque chose de lourd, moi, je me dis qu’un peu d’humour, ça ne fait pas de tort. Je l’imagine, avec sa célèbre moustache, en train de manger une poutine dans un casse-croûte sur le bord du chemin du Roy, la bonne vieille 138, dans le bout de Grondines, proche de Le Frappe-Sacre, avec Simone Monnet-Chartrand, qui lui dit: « Friedrich. Arrête de parler la bouche pleine. »
Le TGV entre en gare de Nantes et je me dirige sans trop de mal vers le tramway. J’essaye d’acheter des billets. Le temps de comprendre le fonctionnement du distributeur automatique, au moins trois rames passent. Mais maintenant que je suis prêt à embarquer, c’est le calme plat. Sauf dans la direction inverse. Là, ça fourmille. Je regarde les gens traverser sous le nez des trams. Moi, je les trouve d’une témérité inouïe, mais ça semble la normalité ici. La trotteuse tourne; je ne pourrai pas rejoindre Fannie à l’heure convenue. Une fois à bord, je me rends compte que j’ai acheté des billets pour rien; c’est gratuit la fin de semaine. Après quelques stations, le tram freine sauvagement, quelques passagers rasent de tomber. Tout le monde se regarde avec des points d’interrogation dans le front. On finit par comprendre qu’un garçon a tenté d’arrêter les wagons avec son genou. Nous nous inquiétons pour lui. Mais après un moment d’affolement général, on le voit passer en claudiquant, en souriant, escorté par la sécurité. Les agents sont peut-être tiraillés entre le soulagement qu’il ne se soit pas grièvement blessé et l’envie de le semoncer solide pour son manque de prudence. Bref, il semble s’en tirer sans trop de mal. Tant mieux. Mais nous voilà immobilisés. Mon retard empire. Je respire. Que veux-tu que j’y fasse? Contrairement à au moins 94% des Canadiens, je ne possède pas de téléphone cellulaire. Dans des moments comme ça, c’est regrettable. Une personne normale appellerait Fannie ou lui enverrait un petit message texte pour l’avertir, par politesse, par courtoisie, c’est ce qui est attendu de nos jours dans les conventions sociales. Mais je suis un dinosaure privé d’intelligence technologie, une sorte d’illettré, un mésadapté, un illectroniste pour être plus précis. Je veux faire partie des quelques irréductibles qui résistent. Le tram se remet en marche. Là et ici, de beaux îlots jaunes, de grands mimosas en fleur illuminent le tissu urbain de leur canopée colorée. J’arrive au terminus de Beaujoire; l’amie m’y attend. En sourire malgré toutes ces grosses minutes à poireauter à cause de moi. Ça fait vingt ans. Vingt ans qu’on s’est vus. Et pourtant, me semble que sa face reste exactement comme dans le temps.
En voyant sur le Livre des visages que je me trouvais en France, elle m’a interpellé, m’a demandé si je pensais aller faire un tour du côté de la Bretagne. Et du même souffle, m’apprenait qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein en juin. Dans les circonstances, ça me paraissait déplacé de m’inviter chez elle : « Je veux surtout pas te fatiguer. Tu le sais, en général, j’ai un pétard dans le cul; je suis pas quelqu’un de particulièrement reposant… »
- Ça me ferait du bien. fut sa réponse.
Et me voilà, dans sa voiture, avec elle, à renouer, dans cette joie que notre âge permet, celle de retrouver une vieille amitié, là où nous l’avions laissée il y a longtemps, et à la fêter. Devant la maison, un camélia fleuri semble d’accord avec moi, me laissant même humer sans dire un mot son parfum rose pâle, mais précis. Le roman d’Alexandre Dumas fils manque à ma culture… À l’intérieur, je fais connaissance avec les trois garçons de dix-sept, douze et huit ans. Le papa, Emmanuel, ne m’a vu qu’une fois, à son mariage, dans le fief de sa solide épouse québécoise, près de Sorel. Mais se souvient bien de moi. Lors du banquet, j’avais poussé « La feuille d’érable » d’Albert Larrieu. Il faut dire que les convives de la famille de l’époux, dotés de bonnes voix et d’un répertoire bien touffu, assuraient avec entrain l’animation musicale de l’événement; c’eut été un tort de ne pas leur rendre la politesse en s’assurant qu’au moins une chanson de chez nous figure dans le programme des réjouissances. Et c’est en prenant le café qu’on se remémore ces bons souvenirs, ensemble, autour de la table de la cuisine, avec album photos à l’appui. Je me pose doucement chez Fannie et Manu après les cinq heures de train entre la Picardie et leur logis. On prend notre temps avant de mettre le cap, à la précoce tombée de la nuit, vers le centre-ville. Où une surprise m’attend. On me dit seulement que je vais rencontrer un éléphant. Mais en fait de découverte, ça m’épate. Après une courte marche en longeant le Bras de la Madeleine de la Loire sous un crachin insistant, nous arrivons aux Machines de l’île, que je décrirais comme un heureux délire steampunk. Normal. On se trouve dans la ville natale de Jules Verne. Évidemment, je ne peux pas revenir à mes quatre ans. Mais ma capacité d’émerveillement semble bien se porter en découvrant ces multiples bibittes mécaniques insolites, prouesses d’imagination débridée, d’ébénisterie extravagante, d’hydraulique organique et d’horlogerie baroque. On regagne ensuite le véhicule en revoyant les vestiges industriels des grands chantiers maritimes, quand on fabriquait ici les transatlantiques de la Belle époque. Une grue jaune et une rampe de lancement, marques monumentales des industries de construction navale, donnent une idée de la taille des bateaux conçus à Nantes dans le temps. Et pas loin, de l’autre côté du fleuve, le Mémorial de l’abolition de l’esclavage nous rappelle que la prospérité de la ville repose en grande partie sur le commerce triangulaire.
Au bar et restaurant Belle de jour, nous cassons joliment la croûte, mais surtout, nous pouvons assister à un spectacle intime de l’ami Clément Bertrand, accompagné par son amoureuse Chloé Girodon. Le violoncelle, ça sublime ses chansons. Et si leur duo marche aussi bien dans la vie que sur scène, mon camarade a clairement trouvé l’eldorado. Après la prestation, nous nous rejoignons dehors. Je présume que Fannie ne veut pas trop qu’on s’attarde, question de ne pas s’épuiser; elle vient quand même de subir une autre chirurgie il y a à peine neuf jours. Mais elle nous assure, Manu et moi, que tout va bien, qu’on peut prendre le temps de fraterniser. Un jeune couple se joint à nous, dehors, on s’adonne bien, on rit, on refait la vie, on la replace dans le sens du monde. Avec Clément, on ne reste pas qu’aux souvenirs des Rencontres qui chantent, à Petite-Vallée et Régina; on voit mieux, respectivement, nos cadeaux du présent, son petit qui grandit, mon mien qui, à quinze ans, me dépasse, dans tous les sens, mais qui reste le meilleur de moi. Et en Chloé, je découvre une femme calme, confiante; ça doit bien étayer mon bon diable de collègue échevelé, poète sensible d’insulaire damné. Je suis sincèrement heureux pour lui, pour eux. Bon, il me paraît toujours inquiet, mais je crois normal que son caractère miroite en synchronicité avec les humeurs du golfe de Gascogne. Un tourmenté, mais capable de carguer sa voile en fonction des vents et marées. On se dit adieu jusqu’à la prochaine. Et nous glissons dans les nocturnes en trille, vers la rue des ombres, la rue de mes splendides hôtes, où un lit de passage encaisse mes ronflements, sans rouspéter.
Dimanche 11.02.2024
Le deuxième fils de Fannie et Manu s’intéresse depuis peu à la religion catholique. Non baptisé, c’est par lui-même, volontairement, qu’il s’est mis à fréquenter l’église. Lorsque sa mère va le réveiller pour qu’il se rende à la messe, il se lève et se prépare, calmement, en silence. Je lui demande si ça l’embête que je l’accompagne. Laconique, il me répond que c’est correct. On y va à pied, par les petites rues, en passant à côté du collège Simone-Veil. En chemin, en lui posant quelques questions, j’apprends qu’il s’intéresse à l’histoire, comme mon fils. À l’école, ces temps-ci, ils étudient les Croisades. Le personnage de Beaudoin IV, le roi lépreux, l’intrigue autant que moi. Nous arrivons au temple dédié à Saint Joseph, qui étire son profil gris dans le matin, vers le soleil. Ça me fait du bien de regarder la lumière du jour dans le blanc des yeux. Anne-Marie, la grand-mère paternelle de mon jeune guide, nous attend devant la porte. À l’intérieur, ça grouille de monde, ça sourit, il règne une sorte de frénésie peu commune pour un lieu de culte. Des notes de flute à bec très justes, assurées, marquent le début de la cérémonie, vite rejointes par la voix pleine de l’animatrice, accompagnée par l’orgue, tout aussi exact et enveloppant. L’assistance se lève pour chanter avec la jeune femme qui me semble vite de loin meilleure dans l’utilisation de ses capacités vocales que la plupart des soi-disant professionnels qu’on entend à la radio, à la télévision ou sur Internet. Elle me fait penser à la Mariette Chiasson de mon enfance, mais encore plus inspirée et inspirante. Tout en humilité, sans fioritures, elle donne les notes dans un timbre chaud et entièrement maîtrisé, juste assez vaste, avec joie, entièrement tournée vers l’assemblée, les guidant avec sa main droite sans rien obliger, avec des gestes amples, mais vigoureux, le corps droit, bien ancré dans le sol, mais quand même souple. La tête haute, l’œil clair, elle s’affirme bellement tout en s’effaçant derrière la musique. C’est assez captivant. Pendant toute la cérémonie, elle remplira l’espace, mais sans en imposer, déposant les mélodies avec modestie. Comment arrive-t-elle à servir aussi bien les chansons, sans aucune prétention?
Les deux curés interviennent ici et là pour assurer le reste de la liturgie, avec un entrain serein. Le célébrant nous apprend que c’est justement un 11 février que Bernadette Soubirous a vu la Sainte Vierge pour la première fois, en 1858. En ce dimanche de la santé, le choix des lectures met bien la table pour l’homélie. Plutôt que de nous adresser un monologue, le prêtre invite quelques personnes, qui travaillent dans le réseau de la santé ou non, à venir présenter des témoignages personnels ou de malades. Tout ça me semble plein de sens. Rendu au Notre-Père, il invite tous les gens en lien avec des malades ou des personnes âgées à venir le rejoindre dans le chœur. Et là, étrangement, l’envie de prier avec tout le monde me prend. Ça fait peut-être trente ans que j’ai pas dit le Notre-Père. Mais en ce moment, je sens un tel esprit de communauté, une telle ambiance de fête, que je laisse ma voix monter avec celle des autres, unies. Je pense à Fannie, avec son cancer du sein. Je pense à mon père, hospitalisé depuis quelques jours à cause d’une crise d’angine. Je décide même d’aller communier après, autre chose que je n’avais pas faite aussi depuis très très longtemps. Un miracle, est-ce que c’est forcément une expérience mystique spectaculaire? Est-ce que certains événements extraordinaires, tout petits, peuvent se dérouler dans l’intimité d’un instant, sans nous rendre fous de religiosité?Plutôt que de retourner à la maison à pied, Madame Anne-Marie vient nous reconduire en auto, son petit-fils et moi. Et elle accepte l’invitation de mes hôtes pour rester à dîner avec nous. Fannie a cuisiné des joues de porc braisées; c’est savoureux. Autant que les conversations heureuses autour de la table. Manu a le tour de placer la bonne humeur autour de lui. Et une fois les enfants levés, Anne-Marie et moi, nous revenons sur la célébration. Nous parlons de l’église, de la foi, de ce que ça peut apporter, dans la vie, une spiritualité basée sur ce pan incontournable de notre civilisation, un patrimoine de lieux majestueux, de somptueuses musiques sacrées, d’œuvres picturales et sculpturales emblématiques, mais aussi de petits gestes simples, de solitudes en silence, de comment ça se passait autrefois, en famille, des prières, des lectures pieuses. Nous nous entendons à merveille Anne-Marie et moi. Je l’écoute me raconter une époque révolue, qu’on aime bien regarder de haut maintenant. On ne se retient pas vraiment de dénigrer ces superstitions, ces simagrées archaïques, des rites soporifiques menés par des vieux monsieurs en robe qui ne manquent pas une occasion de passer outre leurs vœux de chasteté, avec des prépubères de préférence. On se gausse de ces hommes qui ne sont que des hommes, on se scandalise, avec raison, des abus de trop de membres du clergé, endossés, protégés par leur institution, on généralise, on se conforte dans cette posture que l’église de Rome n’est qu’un repère de pédophiles, d’escrocs, de la honte des richesses conservées jalousement par le Vatican pendant que ça crève de soif partout. On les met tous dans le même panier, comme si ça n’existait pas, des prêtres qui ont de l’allure. Comme si toutes les religieuses et les religieux d’aujourd’hui et d’hier ne représentaient pas un des fers de lance du combat universel contre la souffrance. Comme si notre manière de vivre actuelle sophistiquée, frénétique, alcoolique, divertissante, toxique, aseptisée, javellisée, homogénéisée, branchée, rapide, émancipée, décomplexée, subjective, bruyante, individualisée, pixellisée, binarisée, informée, surinformée, désinformée, méta, artificiellement intelligente, algorithmée, design, microdosée, suremballée, armée, vitaminée, vaccinée, hédoniste, eudémoniste, motorisée, postindustrialisée, postdémocratique, ultralégiférée, cyclable, recyclable, compostable, rechargeable, âgiste, botoxée, musclée, angoissée, en vinyle, en mélamine, en acrylique, en polyester, en polystyrène, en tofu, en microplastique, en créatine, en mélatonine, en citalopram, en Ritalin, en Prozac, en dérapage contrôlé constituait le summum, le nec plus ultra, le pinacle, le bout de la marde de l’évolution. Un point dans l’histoire qu’un texte de Serge Carfantan décrit brillamment, dans une glaçante lucidité. Il y a eu du monde avant nous. Et ces gens-là n’étaient pas tous des imbéciles. Bravo pour les changements, mais ce n'est pas toujours synonyme d’évolution. On peut se poser beaucoup de questions sur les manières de vivre des gens d’avant, sur leurs croyances. Mais nos manières de vivre à nous, nos croyances à nous, sont-elles si tant tellement meilleures? Et tout compte fait, devant les proportions pantagruéliques de notre vanité actuelle, il n’est pas mauvais de se rappeler l’insignifiance de notre règne à l’échelle sidérale. (En passant, ce que j’aime particulièrement dans ce reportage d’Arte, ce que les hypothèses concernant la fin de l’univers nous soient expliquées par des femmes, avec brio d’ailleurs.)
En après-midi, avec les enfants, nous allons nous promener dans la partie historique de Nantes. J’absorbe une généreuse dose de beau temps. Fannie attire mon attention sur des détails architecturaux de vieux bâtiments, ceux notamment qui penchent dangereusement, comme des tours de Pise, s’affaissant sous leur propre poids dans le sol remblayé, volé au fleuve. En suivant l’écho lointain d’une fanfare, nous aboutissons sur la place Royale. Il doit bien y avoir deux cents personnes rassemblées autour du groupe de musiciens excentriques et retentissant. Les Trompettes de Fallope nous offrent un spectacle du tonnerre. De Partenaire particulier, que je ne connaissais pas mais qui fait l’unanimité dans le public, au succès Lady Marmalade de Nanette Workman, chanteuse née dans le Bronx mais devenue une vedette en s’établissant au Québec, les airs thérapeutiques de cette belle bande de cinglés issus de la faculté de médecine nous soignent le moral en plus de permettre la cueillette de dons pour je ne sais plus quelle bonne cause reliée à la santé. Nous les quittons un peu à reculons, en fredonnant leurs mélodies. À la place Graslin, je découvre l’opéra et la brasserie La Cigale, avant d’arriver à la Cours Cambronne, où se trouve « Éloge de la transgression », du sculpteur Philippe Ramette; j’aime l’absurde. Manu nous amène à une crêperie en chantant « Aux champs Élysées » de ce bon vieux Joe. Ses garçons se joignent à lui en caracolant sur les pavés polis des ruelles étroites, bellement enchâssées entre les bâtiments médiévaux en colombage. Le resto est aussi charmant que le service et les fines au froment, formidablement quadrillées de caramel au beurre salé, déclenchent un carnaval dans ma bouche, surtout avec la belle bouteille de jus de pomme pétillant qui joue admirablement son rôle de lubrifiant pour faire descendre ce régal exact. Tout ça, gracieuseté de papa Bodineau. Nous voilà bien regaillardis pour attaquer le château des ducs de Bretagne, galoper sur ces murailles massives, ce qui nous donne une sacrée belle trotte au total. Honnêtement, je ne me souviens plus trop de la soirée, mais je sais que ça m’a pas pris une berceuse pour m’endormir. Ah! Ça me revient. J’ai commencé une suggestion de lecture de Fannie : « Le mec de la tombe d’à côté » de Katarina Mazetti. La traduction du suédois fait très franco-française franchouillarde, mais c’est quand même très bien.
Lundi 12.02.2024
À mon réveil, Manu est déjà parti pour le travail et j’ai juste le temps de saluer les garçons avant qu’ils s’en aillent à l’école. Fannie et moi, on reprend notre conversation à deux comme la veille au matin. Elle me parle de son travail à l’université, de sa sœur cinéaste, mais aussi, surtout, d’éducation. On n’est pas pressés, on peut bretter autour d’un café. Mon train part en fin d’après-midi, je n’ai pas de plan précis. « Je pourrais t’accompagner à l’hôpital si tu veux. » Elle renchérit en disant qu’après, elle aimerait aller dîner dans le petit restaurant d’une cheffe danoise et que vu le beau temps, ça serait bien d’aller de se promener dans le Jardin des plantes. Et avant de se rendre à sa clinique, on peut même prendre une petite marche sur le bord de l’Erdre.
Je me sens bien avec Fannie. Son calme, le timbre feutré de sa voix, son regard d’automne en hiver. La conversation coule de source, au fil du cours de l’Erdre, au fil du trajet pour rencontrer son médecin, porteur de bonnes nouvelles concernant sa santé, au fil du repas expressif et de nos pas lents sous la collection cosmopolite d’arbres géants du Jardin des Plantes. Notre lien est une belle énigme. Une pépite de joie que j’avais oubliée, mais que je retrouve, intacte, transmutée même peut-être, améliorée par les années écoulées, par nos destins enrichis de temps conquis. Mon amie me raccompagne à la gare, jusqu’au tourniquet du TGV. On se serre dans nos bras, on se dit à bientôt, sans trop de sentimentalité. Et juste avant de mettre le pied dans l’escalier roulant, je lui dis, je lui crie, mais en chuchotant, juste en articulant exagérément : « Je t’aime. » Comme le comédien qui interprète le père de Bernard Lortie dans « La maison du pêcheur », la scène réussie du film à mon avis.
Dieu est un arbre. Un prodigieux conifère qui respire dans le jardin des plantes de Nantes. Ou son frère, resté derrière, sur leur terre natale, à neuf mille kilomètres de là. Dieu est un canard qui raconte une blague à ses congénères. Une crêpe au caramel savoureuse. Un papa qui chante avec ses fils en gambadant dans une ruelle. Une femme qui vit, curieuse, belle, intelligente, souriante, malgré sa maladie, qui reste digne, sensible, mais résistante, sincère et tranquille. Dieu est une amitié neuve ou de cinq ans ou de trente ans. Dieu est un paysage immobile qui regarde un TGV s’en aller. Le parfum d’une fleur de camélia. Un air de violon improvisé. Un livre réussi. Deux minutes assis sur un banc, les yeux fermés, à sentir la bouche du soleil se déposer sur sa joue.
Samedi 27.02.2024
Cette fois-ci, c’est la bonne. Émilie vient me cueillir à la maison, direction, l’écurie. Pendant que les élèves inscrites à la leçon d’équitation arrivent et dorlotent leurs montures, je fais connaissance avec Corinne, la propriétaire. Est-ce que j’ai bien entendu? Soixante-dix chevaux? Ç’a beau être surtout des poneys Shetland (reconnus comme étant l’un des plus petits équidés du monde), ça fait quand même beaucoup de sabots à soigner! J’apprends qu’ici, contrairement aux pratiques qui me semblent maintenant à la mode en Amérique, on ne nettoie pas les box à la cuillère dès que nos amis quadrupèdes font leurs besoins. À chaque deux semaines, on y va franchement, on enlève toute la litière, hop! Pas d’économie de bouts de chandelles. Côté méthode, je ne sais pas trop comment ils s’y prennent. Est-ce qu’ils procèdent carrément au tracteur? Peut-être que j’aurai l’occasion d’élucider la question un autre tantôt. Mais bon, je constate que les copeaux de bois, si difficiles à décomposer chez nous pour le compost de jardinage, cèdent ici la place à la traditionnelle paille; c’est tellement plus logique. Donc, je n’aurai pas tant de fumier que ça à pelletier. Pour l’heure, je balaie un peu le plancher, je me trouve une brosse, une étrille et je m’en vais m’occuper d’un bon vieux canasson tout crotté de bouette. Il n’a pas l’air de détester l’attention que je lui prodigue. J’apprends plus tard, en discutant avec le patron, que mon nouveau compagnon, hongre âgé de dix-sept ans s’appelle Cherokee. Alexis m’explique aussi que lui, il ne s’occupe pas autant des chevaux que du cheptel de bœufs de boucherie; quatre-vingt-dix belles têtes. En tant que fervent amateur des circuits courts, je m’enquiers de la possibilité de leur acheter de la viande. « Ça pourrait peut-être s’arranger. », que me répond le grand gaillard. Je joue ensuite au snoreau en lui posant quelques questions concernant les cabanes en ruine découvertes par Valentine. Il confirme les informations déjà recueillies concernant la fréquentation des lieux par des estivants, surtout des mineurs du nord, en étayant les informations concernant la mise en place d’une réserve faunique. J’apprends qu’il s’implique comme conseiller municipal d’Étinan (personne ne prononce « Étinéhem » ici). « Échevin » comme j’aime le dire. Bref, il a les deux mains dedans. C’est exactement l’homme qu’il me faut. Quand je dis que je suis un gars chanceux. Et il ajoute une couche qui m’allume. Les étangs carrés qu’on retrouve un peu partout le long de la Somme seraient les vestiges de l’exploitation de la tourbe. Alexis m’explique que du temps de son arrière-grand-père, ça servait encore de combustible. J’ai déjà eu connaissance de cette pratique grâce à un ami qui vient de l’Ardenne. Mais Alexis ne sait pas exactement comment ses ancêtres procédaient. Ça mériterait une petite recherche.
En après-midi, j’enfourche le bicycle généreusement prêté par Thierry pour explorer les environs. J’arrête à la boutique pour véhicules à deux roues de la place Émile Leturcq m’acheter un peu d’huile de vaseline. Le proprio, bien avenant, me conseille une balade vers le monument funéraire de Thiepval m’expliquant le chemin. Ensemble, on déplore qu’il ne puisse pas se trouver de stagiaire pour l’aider. Les vieux métiers qui demandent qu’on se salisse les mains n’ont pas la cote. Et la formule du compagnonnage semble obsolète. Dommage… Je le salue chaleureusement. Et fidèle à mon habitude, je me trompe de chemin. Je me ramasse au cimetière allemand de Fricourt. J’apprendrai plus tard que la dépouille du fameux Baron Rouge passa quelques années là. Je continue de pédaler. Ça fait du bien de suer un peu. Mais le soleil décline. Il faudrait que je pense à m’en retourner à la maison. Mais je suis bien écarté. Et partout où je passe, c’est le calme plat; pas de commerce nulle part, personne dehors, si ce n’est que quelques jardiniers dans le fond de leur cour. Rendu à Montauban, je me trouve un bon Samaritain pour me remettre sur le droit chemin, question d'arriver à Albert avant la noirceur. Il me donne la direction, toute simple, non sans qu’on fraternise un petit peu. Et je m’élance. Après un plateau, la pente descend. Mon bolide prend de la vitesse. Rien pour me lancer dans une carrière de pilote de formule 1, mais je dois quand même utiliser les freins pour m’arrêter au cimetière de l’allée de Dantzig. Je ne pourrai pas me recueillir à chaque fois que je vois des sépultures de soldats de la Grande Guerre, mais quand même.
Jeudi 29.02.2024
Grâce aux contacts d’Émilie, nous nous rendons à la Maison familiale rurale d’Éclusier-Vaux. Je capote! Ils donnent des formations en pisciculture et en aménagement des espaces verts sous la formule travail-études. En fait, il existe environ 400 MFR comme celle-ci sur le territoire français, distribuées sur le territoire en fonction des forces et de l’historique des endroits où elles se trouvent. Toutes basées sur l’alternance entre l’académique et le pratique, elles permettent à plein de jeunes, qui souvent ne cadrent pas dans le système scolaire conventionnel, d’acquérir une panoplie de métiers, principalement manuels, et ce, avec un encadrement empreint de beaucoup de souplesse et d’humanité.
On nous invite à revenir dès demain matin pour les observer travailler dans une anguillère où ils participent à une démarche d'inventaire avec des scientifiques. Je suis vraiment un gars chanceux.
En revenant, on arrête zieuter nos cabanes abandonnées à Étinéhem. Dans un des chemins, deux gars ramassent du bois coupé dans le cadre du grand ménage entamé dans le secteur. Un père et son fils, à peine plus jeune que moi. Je jase avec eux autres pendant que Valentine prend des photos. Je me permets de leur donner un coup de main en cordant leurs bûches dans leur remorque. Super sympathiques, ils bonifient notre enquête sur ce qui se passe comme démarche de revitalisation des rives de la Somme dans le coin. Ça m'inspire au bout comme sujet. Merci à Valentine pour sa super intuition.
Vendredi 1er mars 2024
Quatre anguilles nous attendaient dans la grosse boîte en chêne qui sert de piège. Le contact avec les élèves de la MFR me ravit. Et on s’entend magnifiquement bien avec leur enseignant. Je pose plein de questions sur les anguilles à l’employé de l’Association de pêche, un érudit passionné d’à peine dix-neuf ans, mais déjà d’une redoutable efficacité. Entassés dans le petit bâtiment, je ne prends pas de notes, je bois ses paroles. Et je pense aux liens entre les anguilles d’ici et celles qui fréquentent le Saint-Laurent, entre l’importance historique de cette espèce pour les gens de la Somme et celle qu’elle revêt, dans le berceau de ma famille paternelle. Et ça me touche. Ces liens-là me fascinent. D’ailleurs, le terme « fascine » s’emploie pour désigner la technique de pêche à l’anguille traditionnelle chez nous. Ce que montre magnifiquement bien Jean Guénette dans cet épisode de sa série Vivre de la mer.
Les 15, 16 et 17 mars 2024
Je retourne dans le secteur d’Éclusier-Vaux dans le cadre des activités du Conservatoire des espaces naturels en Hauts-de-France, trois fois plutôt qu’une. Je participe à des corvées de nettoyage. Avec d’autres volontaires, je ramasse des cochonneries qui traînent le long des chemins et autour des étangs; ça ressemble étrangement à ce que je pratique chez nous à tous les printemps comme bénévolat… Je m’implique aussi dans la préservation de ce qu’ils appellent ici un larris, c’est-à-dire de grandes pelouses, généralement en pente, qui poussent sur un terrain calcaire. C’est typique de la Picardie comme composante du paysage. Après avoir tapoché un peu le sentier pour l’élargir à la pioche, notre tâche consiste surtout à dégager une surface confiée à un troupeau de boucs. On coupe des talles d’arbustes avec des sécateurs ou des petites scies manuelles. C’est bon pour le cardio! Ça complète bien mes randonnées à vélo et le temps que je passe à la ferme avec Alexis pour l’aider avec les limousines, les moutons et les poneys. Pour le déjeuner, on est invités à manger du hachis parmentier à la MFR. Au diable mon lunch! Je me régale dans une ambiance magnifiquement conviviale. Quelle belle communauté! D’ailleurs, il faudra que je les relance pour cet été. Il faut absolument que je retourne les voir pendant la deuxième partie de ma résidence…
Vendredi 22 mars 2024
Je dis que ce jour de mon départ s’appelle premier germinal, début du printemps. J’invoque Ricet Barrier, somme Hadrien de se lier d’amitié avec le troubadour comique. Fred, inspirant comme toujours, m’instruit du rapport de la Cour des comptes. À lire absolument. On lève les voiles à bord de la Diaphanemobile. Survolté, je plaisante un dernier coup avec ma bonne fée Estelle, me transforme brièvement en personnage de conte nommé Cendrier. J’ai faim. Ça fait dix semaines que j’ai pas soupé. Le ciel en cendre de cèdre accompagne nos facéties. Mes collègues risquent un léger retard avec les représentant.e.s de la municipalité de Creil. Mais sur le plan tactique, parfois, ce n’est pas mauvais d’être « fashionably late », comme on dit en grec ancien. Francis, le chauffeur du bus 630 m’aide. En échange, je lui promets la célébrité. Un magnolia m’applaudit. En sous-bois, un commando de jonquilles et de primevères prépare une embuscade le long de l’autoroute, mais contre qui, dur à dire. Soudain, l’église de Senlis s’élance dans mon ciel de cendre. Son coq domine. Un monument de cerf fait son fier. Des cortèges de prunus fanent. Un héron vole vers le Parc Astérix. Le soleil aveugle les graffitis. Les moutons chient sous des vitrines de bureaux. Un chevreuil de tôle attend sur l’accotement. Derrière moi, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle et ça bâille moelleusement en créole, en swahili, je ne sais pas. Je cherche une chanson qui ne vienne pas des Misérables de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil. Je trouve la prosodie de Loco Locass : « Comme Diogène avec son fanal je cherche un homme en moi /Qui ne soit pas celui que je vois mois après mois. » Même s’ils ont pas été fins avec moi au parc Roland Beaudin. Roland Beaudin, ça me fait penser à l’ami Gueze. Dans les bretelles de bitume, les pancartes, 110, 90, 70 se succèdent en ribambelle. Assis, discipliné, je pratique mon métier. Je pense à Paris, me dit qu’il s’agit d’une formidable calamité. Mes bagages embarquent dans un chariot et se trompent de chemin. Dans un escalier roulant, des fesses en jeans ne m’impressionnent pas. Je roule dans le Léviathan, hésitant. Je pratique mon métier. On m’aide, on m’ignore, on m’oriente, on me demande, on m’indique, on me sert, on me parle, on m’empeste, on me scanne, on prend mon argent, on me questionne, on me cuit, on rase de me collisionner, on sympathise avec moi, même dans cet antre du chacun pour soi. Longue longue queue-leu-leu pour attendre d’embarquer. Comme les pratiquants de mon enfance qui se dépêchent d’aller communier. Je reste assis. Je suis pas pressé. Je pratique mon métier. Je pleure. Deux ans jour pour jour après ma naissance, Pierre Goldman est déclaré non coupable du double meurtre dont on l’accusait. En 1979, trois ans après sa sortie de prison, il est assassiné dans des circonstances toujours non élucidées, meurtre revendiqué par le groupe d’extrême droite Honneur de la police. Dix mille personnes assistèrent à ses funérailles. Merci à Cédric Kahn pour son film. L’Atlantique chatoie sous l’avion pendant que mon voisin de gauche rote et pète. Henri Grouès, l’abbé Pierre, me fait pleurer en compagnie de Lucie Coutaz, interprétée par Emmanuelle Bercot, belle comme ma matante Monique, dernière religieuse de la Congrégation des Militantes mariales. Je pratique mon métier. Le voyage me ramène cinq heures en arrière. Le Léviathan de ma destination me mâchouille, mais finit par me recracher. Je cherche du regard Xavier, censé venir me cueillir avec mes bagages, avec mon char. Mais à travers les quidams de l’aéroport, c’est mon fils que je vois gambader vers moi. Je me sens lever de terre, soulevé par ses muscles et ma surprise. Sa mère suit, pas loin derrière. La femme que j’aime. Avec qui je me sens si bien, si complet, si plein, si porté vers une inaccessible sainteté. Et c’est comme ça que mon pays me dit oui, le pays de ma famille.